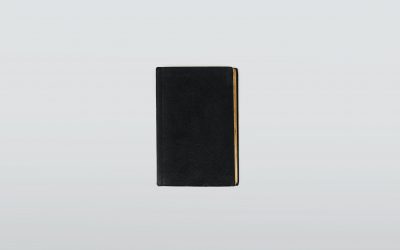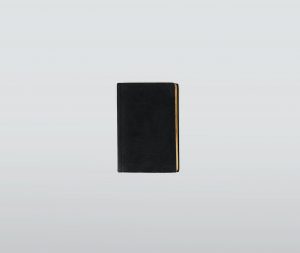par Farida Tahar | 27 septembre 2021 | Emploi et formation, Parlement Bruxellois, Questions parlementaires
Un article de Sudpresse du 6 septembre dernier faisait état du taux de chômage dans plusieurs communes bruxelloises et wallonnes. Si 62 % des communes wallonnes se portent mieux économiquement qu’il y a deux ans,elles ne sont que 21 % à Bruxelles.Tandis que les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Watermael-Boitsfort affichent des taux de chômage plus bas, trois communes bruxelloises arrivent tristement en tête du podium du plus haut taux de chômage :Molenbeek-Saint-Jean (22,2 %), Saint-Josse-ten-Noode (21,4 %) et Bruxelles-Ville (18 %). Ces communes sont celles affichant l’indice socio économique le plus faible et les inégalités sociales les plus visibles.Nous le savons, parmi les chercheurs d’emploi, les jeunes sont particulièrement victimes de l’accroissement du chômage, en particulier ceux qui entrent pour la première fois sur le marché du travail, qui plus est dans un contexte de pandémie mondiale.Les conséquences socio économiques de la crise sanitaire vont continuer de se faire sentir longtemps, entre autres sur la disponibilité d’offres d’emploi sur le marché du travail bruxellois.Le plan de lutte contre le chômage ne doit pas oublier les chercheurs d’emploi qui, avant la crise, se trouvaient déjà dans une situation d’éloignement du marché du travail. Pour les écologistes, les dispositifs visant l’insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle de ces publics doivent être renforcés,évalués et pérennisés. Il s’agit ici des chômeurs de courte et de longue durées, ces publics ne doivent pas être opposés.En 2014 déjà, la garantie solutions avait été mise en place pou la jeunesse. Elle prévoyait un emploi, un stage ou une formation à chaque jeune s’inscrivant chez Actiris. Dans la déclaration de politique régionale, il était prévu de l’étendre à tous les demandeurs d’emploi bruxellois.
Dans ce contexte, j’ai demandé à Monsieur le Ministre ;
Où en est la mise en œuvre de l’objectif noble de trouver un emploi, une formation ou un stage pour les jeunes, et plus largement pour les chercheurs d’emploi de tout âge ? Comment cet engagement pourra-t-il prendre forme dans le contexte d’après la crise du Covid-19 ? Quelles stratégies allez-vous mettre en place pour soutenir le public de jeunes chercheurs d’emploi, ainsi que les chômeurs de longue durée ?
Des assouplissements du cadre normatif de contrôle de la recherche active d’emploi sont-ils possibles ? Dans l’affirmative,comment seront-ils mis en œuvre ? Quelles évaluations faites-vous des mesures de soutien, notamment la prime Phoenix, mises en place durant la crise sanitaire pour pallier les pertes d’emploi dues aux faillites d’entreprises et pour soutenir l’insertion professionnelle des chercheurs d’emploi ?
Voici la réponse que j’ai reçue :
M. Bernard Clerfayt : Il est évident que les chiffres du chômage ont suivi le cycle de la crise sanitaire : en raison du gel du marché de l’emploi dû au confinement et aux conséquences de la crise, les jeunes arrivant sur le marché du travail ont eu plus de mal à trouver un emploi. Cela a entraîné une forte hausse du chômage des jeunes en Région bruxelloise.Toutefois, depuis que nous enregistrons un début de reprise économique, le chômage des jeunes est en diminution. Je ne commenterai pas les différences de niveau de chômage entre les communes. Nous savons les différences profondes qui les caractérisent et le dualisme présent en Région bruxelloise, avec des communes plus riches et plus pauvres, et des communes où le taux de chômage est plus élevé que d’autres, en raison notamment d’un niveau de formation plus faible.Comme il existe déjà des dispositifs et des mesures pour les jeunes chercheurs d’emploi et les chômeurs de longue durée, il n’est pas prévu de développer des stratégies supplémentaires à destination de ces publics cibles. Comme vous l’avez rappelé, la garantie jeunesse d’Actiris, proposée par son service Youth Guarantee d’après le nom européen du dispositif, a été mise en place en 2014. Elle a pour objectif de soutenir et accompagner les jeunes chercheurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, et de leur proposer un stage, un emploi ou une formation.Le chômage des jeunes a sensiblement diminué de 2014 à 2020,jusqu’au début de la crise. Ces résultats laissent à penser que ce programme a été très efficace. En dehors des interruptions dues à la crise économique liée à la crise sanitaire, nous pouvons donc espérer que les mêmes dispositifs auront les mêmes effets de réduction progressive du chômage des jeunes.En raison de la pandémie, les offres d’emploi et de stage ont fortement diminué, ce qui a considérablement perturbé le fonctionnement du programme. Nous assistons actuellement à une reprise de l’activité, qui permettra à nouveau à Actiris de proposer des solutions aux jeunes chercheurs d’emploi.Le dispositif garantie solutions est accessible, depuis 2019, à l’ensemble des nouveaux chercheurs d’emploi inscrits auprès d’Actiris. Dans son accord de majorité, le gouvernement a pris l’engagement de garantir l’extension de ce dispositif à tous les chercheurs d’emploi volontaires. Actuellement, tout chercheur d’emploi de longue durée a la possibilité de bénéficier d’un accompagnement volontaire, à sa demande.L’ensemble des services d’Actiris sont accessibles aux chercheurs d’emploi de longue durée. Leur sont également accessibles les dispositifs d’aides à l’emploi tels que la prime Activa ou encore le dispositif d’économie sociale.Les investissements dans ce dernier dispositif ont d’ailleurs sensiblement augmenté à la suite de la réforme mise en place par mon prédécesseur, M. Gosuin, qui est exécutée sous la législature actuelle.Le cadre normatif de contrôle de la recherche active d’emploi est une compétence fédérale. La Région bruxelloise n’a pas la faculté de le modifier. Par contre, nous sommes chargés de son exécution pratique et des procédures particulières de vérification de cette recherche active d’emploi. Notre marge de manœuvre se situe donc au niveau des procédures mises en place, dans le respect de ce cadre normatif.
C’est pourquoi, dès le début de la crise du Covid-19, Actiris a proposé des adaptations devant lui permettre de continuer à réaliser les activités en lien avec le contrôle de la disponibilité,tout en les assouplissant, pour tenir compte des circonstances particulières engendrées par la crise. Toutes ces activités de contrôle ont été réalisées de manière entièrement digitale lors des différents confinements. Ceci signifie que seules les analyses de dossiers ont été exécutées par les évaluateurs.Nous avons également mis en place un « moment d’état des lieux et de vérification » à partir de décembre 2020, soit après quelques mois de confinement. Il s’agissait d’un contact téléphonique destiné à tous les chercheurs d’emploi pour lesquels il n’était pas possible d’aboutir à une décision positive. C’était une occasion de reprendre contact avec le chercheur d’emploi et de faire le point avec lui sur la procédure et les actions à entreprendre. L’intention n’était donc pas de constater qu’il n’avait pas fourni assez d’efforts à la fin de l’année 2020 ou au début de 2021, dans le contexte particulier de la crise, mais au contraire de faire le point avec lui sur la manière dont il pouvait se diriger vers le marché de l’emploi, gelé à l’époque.Enfin, vous m’interrogez sur la prime Phoenix. Développée sur la base de rapports d’évaluation préparés par perspective.brussels et par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse, elle prévoyait en juillet 2019, lors de sa mise en place, que nous allions connaître une vague de chômage très importante à la fin de l’année 2019. Une augmentation de 20.000 à 30.000 chômeurs était prévue. Nous avons donc développé la prime Phoenix en vue d’absorber un flux de 25.000 chômeurs supplémentaires.C’est ainsi qu’un montant de 30 millions d’euros a été dégagé pour l’année 2021. À ce jour, seuls 931 chercheurs d’emploi ont bénéficié de cette prime dans le cadre d’un nouvel emploi. C’est peu par rapport à nos ambitions qui visaient 5.000 ou 6.000 personnes. Je rappelle cependant que, lorsque nous avons introduit cette prime, nous nous attendions à 25.000 chômeurs supplémentaires. Grâce aux mesures de chômage temporaire prises par l’État fédéral, nous n’en avons enregistré « que » 2.000. Au total, si 931primes délivrées peuvent paraître constituer un mauvais résultat par rapport à ce que nous avions anticipé, le bilan est en réalité relativement bon : nos projections n’étaient plus valables dès lors que l’État fédéral a décidé d’octroyer un statut de chômage temporaire et de prolonger la mesure jusqu’à la fin décembre2021. C’est donc une bonne nouvelle au regard de tous les éléments.Je me réjouis de la prolongation de ces mesures par l’État fédéral. C’est à partir du début 2022 que nous verrons si l’état de certains secteurs économiques entraînera des faillites et des pertes d’emplois. Dans ce cas, nous pourrons mobiliser la prim ePhoenix, qui a déjà démontré son efficacité auprès d’un millier de travailleurs et qui pourra encore être appliquée au début de l’année 2022
Le compte-rendu intégral de la commission est disponible ici : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2021-22/00016/images.pdf
par Farida Tahar | 10 août 2021 | Emploi et formation, Parlement Bruxellois
Voici le compte-rendu de mes questions et réponses du Ministre à ce sujet ;
Un an après la réforme du dispositif article 60, je souhaite vous interpeller sur son état d’avancement. Une partie de l’enveloppe d’environ 53 millions d’euros prévue en 2021 pour des mesures de soutien à l’emploi servira à renforcer le dispositif article 60. Ce renforcement prendra la forme d’une augmentation du nombre de postes sous contrat article 60, notamment pour les entrepreneurs bruxellois victimes de faillites. Dans ce cadre, 2.250.000 euros seront destinés aux nouveaux postes article 60 pour les indépendants et une enveloppe budgétaire de 900.000 euros est prévue pour le renforcement et l’encadrement de ces mises à l’emploi.Ces allocations budgétaires remettent un coup de projecteur sur le dispositif d’insertion socioprofessionnelle. Les contrats article 60 sont des contrats à durée déterminée proposés par les CPAS à leurs allocataires, afin de leur donner l’opportunité d’obtenir ou de retrouver leur droit au chômage et de reprendre pied sur le marché du travail par une expérience professionnelle. En 2019, votre prédécesseur, M. Gosuin, a entamé une réforme de ce dispositif. L’ordonnance du 28 mars 2019 – que le groupe Ecolo avait largement soutenue à l’époque – met en place un cadre régional reconnaissant légalement les missions d’insertion socioprofessionnelle des CPAS. L’ordonnance vise également l’harmonisation des pratiques des dix-neuf CPAS bruxellois et le renforcement du volet qualitatif du dispositif, notamment les aspects relatifs à la formation.L’arrêté d’exécution de cette ordonnance a été publié le 23 mai 2019, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans sa déclaration de politique régionale (DPR), le gouvernement prévoit bien de poursuivre cette réforme. La lettre d’orientation qui accompagne les documents budgétaires de 2021 précise notamment que le travail de réforme du dispositif article 60 sera poursuivi cette année.
Disposez-vous de chiffres sur le dispositif des emplois d’insertion à Bruxelles ?
Combien de personnes sont actuellement employées sous contrat article 60 ? Disposez-vous de chiffres ventilés par utilisateurs internes et externes des services des CPAS ?
Disposez-vous de leur répartition genrée ?
Des statistiques sur la réinsertion professionnelle des personnes ayant bénéficié d’un contrat article 60 existent-elles, y compris en fonction de l’utilisateur interne ou externe et du genre du travailleur ?J’aimerais également vous interroger sur l’avancement de la mise en œuvre des différents axes de la réforme.
Quel rôle joue Actiris dans le suivi, le soutien et le contrôle de la mise en application de la réforme ? Quels retours avez-vous des CPAS et des partenaires sociaux au sujet de la réforme ? Quel bilan faites-vous de l’harmonisation des pratiques des dix-neuf CPAS bruxellois en matière d’emploi d’insertion ?
L’article 8, § 4, de l’arrêté du 23 mai 2019 stipule que « la rémunération appliquée ne peut être inférieure à la rémunération minimum applicable en exécution de la circulaire du 28 avril1994 relative à la charte sociale applicable aux pouvoirs locaux ». Le barème minimum appliqué aux emplois d’insertion a été rehaussé au niveau du barème minimum des pouvoirs locaux.Il est très positif que ce seuil ait été revu. Comment cette disposition est-elle appliquée ? Le barème minimum appliqué est-il bien le même dans tous les CPAS ? Cette disposition fait-elle l’objet d’un contrôle spécifique ? Si ce seuil est une première avancée, l’objectif à viser reste la mise en place, dans le cadre des emplois d’insertion, d’une référence salariale barémique en fonction des tâches et des types de postes. Une réflexion est-elle entamée dans ce sens ? Quels sont les obstacles à l’utilisation d’une telle référence barémique ?
L’arrêté d’exécution prévoit à l’article 7 que la Région, en concertation avec Actiris et les CPAS, établira des modèles de convention de mise à disposition et de plan d’acquisition de compétences. Où en sont ces modèles ?Je ne vais pas lire les questions sur le volet accompagnement et formation, vous les avez reçues et je ne doute pas que vous y avez été attentif. Est-il prévu d’évaluer le dispositif dans le courant de cette législature ? Un calendrier a-t-il été fixé ? Qui sera chargé de réaliser cette évaluation ?
M. Bernard Clerfayt : Mme Tahar, je vous remercie pour votre question, qui m’offre l’occasion de faire le point sur une réforme importante.Comme vous l’avez rappelé, celle-ci a été engagée par mon prédécesseur, le ministre Gosuin, à la fin de la législature précédente. Sa mise en œuvre s’est donc imposée à moi dès mon entrée en fonction.La volonté était d’harmoniser les pratiques des différents CPAS en matière de recours à cette disposition de la loi sur les articles 60 pour mettre au travail des personnes en recherche d’emploi et leur permettre ainsi de retrouver les droits sociaux dont bénéficient les demandeurs inscrits à l’ONEM.Il ne s’agit pas seulement de transférer une charge, mais également de rendre tous les droits liés à la reconnaissance des droits sociaux de tout citoyen inscrit en tant que chômeur complet indemnisé. C’est par ailleurs un aspect important en matière de stratégie d’émancipation de ces personnes : retrouver des droits pleins et entiers.Une autre ambition était de veiller à accroître les qualifications de ces personnes à l’issue des mois – voire des années – durant lesquels celles-ci étaient placées sous le statut de l’article 60.Notre constat était que ce statut pouvait dans certains cas se rencontrer dans le cadre de certaines fonctions publiques ou parapubliques, tandis que les personnes concernées ne tiraient pas profit de cette période pour améliorer leurs qualifications professionnelles et se rapprocher ainsi du marché de l’emploi,avec de plus grandes chances d’obtenir un emploi dans une autre structure que celle dans laquelle ils avaient travaillé de nombreux mois sous le statut de l’article 60.Deuxièmement, cette ordonnance a bénéficié d’un soutien politique considérable, avec de fortes ambitions. Elle est très largement partagée et cela me paraît un élément particulièrement positif. Il s’agit d’une heureuse réforme, non conflictuelle et assise sur un vaste socle de volonté politique.
Malheureusement, il faut reconnaître que le contexte de crise a quelque peu bouleversé la manière dont les CPAS sont amenés à mettre en œuvre cette réforme. La crise sanitaire entraîne de nombreux retards et difficultés liés à l’état actuel du marché de l’emploi. Je n’ai pas de réponses à vos dernières demandes d’informations statistiques. Si vous posez des questions écrites, je veillerai à vous fournir les informations que je pourrai récolter.Les dernières données d’Actiris dont je dispose sur le nombre de personnes employées sous contrat article 60 datent du 30 novembre 2020. À cette date, le dispositif concernait 4.987. travailleurs, à savoir 2.707 femmes et 2.280 hommes, soit une proportion d’environ 55/45 %.Actiris ne collectant pas de données concernant les ventilations par utilisateur externe, je vous invite à adresser vos questions à cet égard aux ministres compétents de la Cocom, qui ont la tutelle sur les CPAS. En 2020, view.brussels – le bureau d’études d’Actiris – a réalisé une étude longitudinale sur des cohortes d’individus sortis d’un emploi dit article 60 en 2016 et 2017 afin de déterminer les effets de ce dispositif. Ce suivi, qui concernait 2.172 personnes en 2016 et 2.696 en 2017, permet une ventilation des données en fonction du sexe ou genre des bénéficiaires, mais pas d’identifier le type d’utilisateur. Sur la base de ces cohortes, deux catégories d’informations différentes mais complémentaires peuvent être retenues pour déterminer l’incidence du dispositif sur la réinsertion socioprofessionnelle de ses bénéficiaires.La première information concerne le taux de sortie vers l’emploi.Cet indicateur représente la proportion de sorties vers un emploi par rapport au nombre total de personnes ayant terminé la période article 60 Actiris retient ici le taux de sortie vers l’emploi des individus ayant été employés trois mois consécutifs, car ce public illustre davantage une insertion durable dans le domaine de l’emploi.Le taux de sortie vers l’emploi après trois mois s’élevait à 36 % – soit 780 personnes sur 2.172 – en 2016 et à 34 % – soit 922personnes sur 2.696 – en 2017. En d’autres termes, un bon tiers des citoyens article 60 est employé pour trois mois après trois mois d’inactivité.Si nous examinons la manière dont ce taux se présente en fonction du genre des sortants, nous remarquons que les hommes affichent un taux de sortie vers l’emploi plus élevé que celui des femmes. Pour les hommes, ce taux est de 38 % en 2016 et de 35 % en 2017, alors qu’il n’est que de 33 % pour les femmes sur les deux années. La différence n’est pas énorme mais elle est tout de même interpellante. La seconde information disponible fournit plutôt une photographie de la situation à un instant T, dans le sens où elle indique la position socio-économique dans laquelle se trouvent les anciens travailleurs sous contrat article 60, paragraphe 7,douze mois après leur sortie du dispositif. Sur l’ensemble des sortants de l’article 60 en 2016, 24 % étaient en emploi douze mois plus tard, contre 25 % en 2017.En 2016, les 2.172 sortants se répartissent comme suit : 1.317hommes et 855 femmes. Parmi eux, 25 % des hommes se trouvent en emploi, contre 23 % du côté des femmes, douze mois après la fin du contrat. La différence est marginale mais bien réelle. En 2017, les 2.696 sortants sont composés de 1.576hommes et de 1.120 femmes. Parmi eux, 26 % des hommes sont en emploi douze mois plus tard, contre 24 % des femmes. La différence est, une fois de plus, assez légère.
Statistiquement, la fréquence à laquelle les hommes trouvent un emploi est donc légèrement supérieure à celle observée chez les femmes. Les données ne permettent cependant pas d’interroger la qualité de l’emploi, notamment du point de vue de sa durée,de sa rémunération ou encore de la nature de la fonction exercée.1173S’agissant du rôle d’Actiris dans la mise en œuvre de la réforme,de nombreuses rencontres ont eu lieu entre le département partenariats d’Actiris et les secrétaires et responsables des services d’insertion socioprofessionnelle (ISP) de chacun des dix-neuf CPAS bruxellois entre juillet et octobre 2019. Des réunions techniques – notamment en vue de finaliser la réforme -se sont tenues fin décembre 2019. Cette réforme a donc engendré un important travail de concertation entre les CPAS, mon cabinet et Actiris en vue de finaliser les documents à utiliser pour chaque contrat, ainsi que les modalités de paiement des nouvelles primes. Dans le cadre de l’arrêté du 23 mai 2019, Actiris a joué plusieurs rôles dans la mise en œuvre et le suivi de cette réforme, à commencer par un rôle de financement, par le paiement de la prime de 350 euros par poste article 60 aux CPAS, qui consiste en un soutien financier à la gestion administrative et sociale de l’emploi d’insertion tel que stipulé par l’article 19 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (AGRBC). Actiris joue également un rôle de contrôle, par l’approbation des rapports annuels à transmettre par les CPAS, un rôle de gouvernance – par sa participation au comité de suivi instauré par l’arrêté du gouvernement – ainsi qu’un rôle d’appui technique et de soutien aux CPAS, par la réponse apportée aux nombreuses questions techniques spécifiques envoyées sur une adresse générique, ainsi que par l’instauration d’une foire aux questions pour le suivi de ces dossiers durant la crise sanitaire. Un véritable travail d’accompagnement est donc effectué. Enfin, Actiris joue un rôle de rapportage, par la transmission des informations relatives à la synthèse des rapports annuels des dix-neuf CPAS tel que prévu dans l’arrêté du gouvernement, ainsi qu’un rôle d’avis et de décision, lorsque son comité de gestion analyse les projets concernant la réforme des différents outils de ce mécanisme. Les modèles de documents ont ainsi été soumis au comité de gestion d’Actiris en février et en mai 2020, après concertation avec les CPAS. S’agissant du retour des CPAS, ceux-ci ont été consultés, et dix CPAS sur dix-neuf ont répondu. D’une manière générale, la mise en place de la réforme et la mise en œuvre des outils et des nouveaux modèles de conventions ainsi que le processus de collaboration avec les partenaires s’organisent progressivement.Il s’agit d’une réforme complexe dont la mise en œuvre pose parfois des difficultés. Pour certains CPAS et cellules ISP, on nous rapporte que les agents partagent les objectifs de de cette réforme, tels que l’harmonisation des pratiques ou les meilleures qualifications des personnes engagées sur la base de ces contrats. Les agents saluent cette réforme et sont clairement engagés dans sa mise en œuvre.
Ils accueillent favorablement les nouveaux outils tels que le plan d’acquisition des compétences. Néanmoins, les CPAS indiquent que la mise en œuvre de la réforme a également engendré une surcharge administrative dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire. En effet, la mise en œuvre de cette réforme date du début 2020, lors de l’arrivée de cette crise qui a entraîné l’afflux d’un public nouveau pour les CPAS. Il s’agit donc de circonstances assez difficiles et malheureuses pour la mise en œuvre de cette réforme. En outre,l’ampleur des changements exigés par l’arrêté a nécessité des adaptations, des procédures et une information de tous. Un CPAS témoigne également de la volonté de chercher en2021 des formations adéquates pour ce qui est de l’utilisation du plan d’acquisition des compétences. Pour le moment, ce type de formation fait parfois défaut dans l’offre de formation.Vous m’interrogez également sur l’évaluation. Cette dernière me semble prématurée, car il faut d’abord déployer le système. La crise sanitaire ralentit ce déploiement et perturbe sa mise en œuvre par les CPAS. Dès lors, nous ne procéderons certainement pas à une évaluation avant la fin de cette année et même – soyons réalistes – pas avant 2022. Cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.S’agissant de l’harmonisation des pratiques, le bilan sera réalisé par le comité de suivi. Il est encore trop tôt pour se prononcer,dans la mesure où certains CPAS n’ont pas encore mis en œuvre tous les outils. Par ailleurs, comme je viens de l’expliquer, la crise sanitaire en 2020 a considérablement ralenti la mise en œuvre. En conclusion, la réforme représente indéniablement un pas important dans le processus collectif d’harmonisation des pratiques entre les CPAS. Le simple fait que les CPAS communiquent entre eux et échangent avec Actiris les amène déjà à s’interroger sur telles ou telles pratiques et sur la façon de les faire converger. Ne sous-estimons pas non plus l’important travail de collaboration, de concertation et d’harmonisation effectué au sein des groupes de travail qui réunissent les services d’insertion socioprofessionnelle et les dix-neuf CPAS. Chacun de ces acteurs connaît des réalités et des méthodes de travail différentes,de sorte que tout ce travail prend un certain temps. Enfin, nous constatons une réelle volonté partagée de persévérer dans cette logique d’harmonisation, mais il faudra encore patienter pour pouvoir en observer les effets.
Les deux millions d’euros du plan de relance accordés aux particuliers ne sont pas le seul moyen d’aider les indépendants en difficulté. Je peux comprendre qu’il y ait des indépendants en difficulté qui ne souhaitent pas recevoir d’aide. Néanmoins, l’idée était de permettre aux CPAS de mieux accueillir les indépendants qui avaient fait ce choix-là et de prévoir les moyens budgétaires pour que les CPAS disposent de davantage de formules article 60 qu’ils n’en disposent actuellement.La crise allait en effet amener un surcroît de personnes auprès des CPAS, sachant que ce public des indépendants n’a pas droit au chômage et est confronté à des difficultés particulières. À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour disposer de chiffres.Grâce aux mesures du gouvernement fédéral, à savoir le droit passerelle et le chômage temporaire, le nombre de personnes inscrites au chômage et émargeant au CPAS n’a pas été aussi élevé que nous ne le craignions en juillet dernier. Par ailleurs,les CPAS avaient réagi positivement aux mesures de soutien permettant de mieux accueillir une partie d’un public fragilisé
J’ai ensuite répondu à M. Le Ministre ;
Je vous remercie, M. le ministre, pour votre réponse très étayée. J’attendais les chiffres que vous avez cités et continuerai d’attendre ceux dont vous ne disposez pas encore. J’avais bien conscience qu’il était risqué de vous poser une question relative au volet d’évaluation dans ce contexte particulier ayant ralenti le travail d’accompagnement des chômeurs de longue durée.Il se pose aujourd’hui la question des publics qui entrent malheureusement – et malgré eux – en concurrence, à savoir les nouveaux chômeurs, les chômeurs temporaires et les chômeurs de plus longue durée. Nous avons aujourd’hui le sentiment que de nombreux dispositifs sont à l’arrêt, et nous saluons bien évidemment l’ordonnance relative à l’article 60, que tous les partis politiques avaient convenu de soutenir. Vous faites bien de rappeler à quel point il est important de fournir un travail de qualité. Nous avons souvent, et à juste titre, critiqué certains dispositifs d’insertion à l’emploi, non pas pour leur objectif de mise à l’emploi, mais pour leurs conditions précaires. La réforme de cette ordonnance démontre une volonté d’harmoniser les pratiques disparates au sein des CPAS et deviser la qualité.Vous évoquez un taux de 37 %. C’est un bon début, même si j’espère que ce chiffre augmentera et qu’il atteindra au moins la moyenne. Je note également une légère différence en ce qui concerne l’insertion des femmes. Il serait intéressant de comprendre les raisons de ce, qui sont probablement d’ordre privé et familial. Nous devons accorder une attention particulière à l’insertion des femmes, qui composent la moitié de notre société. Je note la volonté des CPAS de se joindre à cette harmonisation. J’interpellerai éventuellement M. Maron pour ce qui concerne la tutelle des CPAS. J’entends qu’il serait inutile de revenir vers vous dans les prochains mois à ce sujet. Je serai patiente et attendrai donc la fin de l’année.
Compte-rendu intégral de la commission disponible ici : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00079/images.pdf
par Farida Tahar | 14 juin 2021 | Au parlement, Emploi et formation, Parlement Bruxellois, Questions parlementaires, Travail politique
Voici ce que j’ai demandé au Ministre ;
« Il me revient que la réouverture d’antennes Actiris fermées depuis le début de la pandémie de Covid-19 est compromise. C’est notamment le cas de l’asbl Créemploi, un atelier de recherche active d’emploi situé à Woluwe-Saint-Pierre. En réalité, Actiris a conclu une convention avec des asbl partenaires, qui les oblige à assurer un accompagnement complet des demandeurs d’emploi moyennant un financement d’Actiris. Pour l’antenne de Woluwe-Saint-Pierre, il s’agit plus précisément d’un accompagnement de demandeurs d’emploi titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur au certificat d’enseignement secondaire supérieur. Les antennes liées par convention doivent justifier des actions menées pour chacun des demandeurs d’emploi et prouver leur réalisation. Il semble qu’un renouvellement desdites conventions soit prévu pour septembre 2021, ainsi que pour l’année 2022 et les suivantes.Une fermeture définitive des antennes d’Actiris dans certaines communes est également annoncée. Actiris confirme son intention de fermer ses structures locales dans certaines communes et envisage de confier ces missions de base aux partenaires locaux. Si cela était confirmé, pareille situation serait dommageable pour les demandeurs d’emploi des communes concernées, qui se verraient ainsi privés des structures locales d’Actiris et d’un accompagnement spécifique. Or nous savons combien ces antennes remplissent des missions importantes en matière d’insertion professionnelle, tout particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire.
Confirmez-vous le projet de fermeture d’antennes d’Actiris dans certaines communes bruxelloises? Dans l’affirmative, qu’est-ce qui le justifie?Avez-vous pris contact avec Actiris et/ou les responsables de ces antennes pour dégager des solutions? Dans l’affirmative, lesquelles?Qu’est-il prévu pour faire face à ces fermetures et répondre aux demandes de réinsertion professionnelle de nombreux demandeurs d’emploi bruxellois? »
M. Bernard Clerfayt, ministre, a répondu que l’asbl Créemploi est un atelier de recherche active d’emploi, partenaire d’Actiris. Ces partenaires associatifs sont mobilisés dans le cadre de l’accompagnement des nouveaux chômeurs issus de la crise. Cette asbl a dû fermer son accès aux chercheurs d’emploi dès le 13mars 2020, au début de la pandémie, en application des mesures sanitaires strictes prises à ce moment-là. De très nombreux partenaires et des antennes locales d’Actiris ont dû faire de même. Selon mes informations, Créemploi a repris ses activités le 3 juin 2020. D’après vous, des antennes d’Actiris fermeront définitivement leurs portes dans certaines communes. Je l’ignorais. J’ai interrogé des responsables chez Actiris, qui l’ignoraient également. Je vous confirme qu’à ma connaissance, et jusqu’à preuve du contraire, Actiris ne projette pas de fermer ses antennes dans quelque commune que ce soit.

par Farida Tahar | 26 mai 2021 | Au parlement, Emploi et formation, Parlement Bruxellois, Travail politique
La crise sanitaire et les mesures de confinement ont rapidement mis en lumière une série de métiers, de travailleurs et travailleuses, auparavant peu considérés ou peu reconnus socialement, à savoir les métiers dits essentiels, que nous avons tous applaudis de nos fenêtres et balcons durant le premier confinement.
Parmi ces métiers essentiels ou de première ligne, on retrouve tous les métiers relevant du travail du care. Cette notion de « care » désigne les activités et professions liées au soin aux personnes et dans lesquelles les dimensions non directement médicales -attention, soutien moral et psychologique, réponse aux besoins-occupent une place centrale. Aides soignantes, aides familiales, aides ménagères, gardes à domicile, nounous…, autant de professions qui ont en commun une part écrasante de travailleuses. Il s’agit de professions essentiellement féminines. Outre cette surreprésentation féminine, et à cause de celle-ci, les métiers du care sont des métiers largement dévalorisés, tant au niveau symbolique qu’au niveau salarial. Le secteur des métiers du care est aujourd’hui encore un secteur largement méconnu, négligé et invisibilisé, au sein duquel le travail s’effectue dans des conditions particulièrement précaires. Il est d’ailleurs nécessaire de rappeler que ce secteur emploie de nombreuses femmes sans papiers. Elles vivent et travaillent sans aucune couverture sociale, dans des conditions de grande précarité et vulnérabilité que la crise sanitaire n’a fait qu’exacerber.
Le contexte sociétal actuel devrait pourtant nous inciter à soutenir et développer durablement le secteur du care. En Belgique, comme dans de nombreux pays occidentaux, les besoins en travail du care, en services aux malades et aux personnes âgées et en garde d’enfants vont croissant, notamment en raison du vieillissement de la population. Comme l’ont cruellement montré les importantes pénuries de main-d’œuvre dans les institutions de soins pendant la crise, le marché du travail peine à y répondre. Lors d’une de mes précédentes questions, vous aviez répondu qu’une étude détaillée sur le secteur du care à Bruxelles serait intégrée à l’évaluation de la qualité de l’emploi que view.brussels a prévu de réaliser en collaboration avec les interlocuteurs sociaux.
Parmi les recommandations formulées dans le rapport du Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes sur l’impact du Covid-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes à Bruxelles figurent la reconnaissance et la revalorisation de ces métiers essentiels. Il s’agit notamment de soutenir, de manière structurelle, les métiers du care et de la santé en leur assurant de bonnes conditions de travail, une rémunération plus juste fondée sur les valeurs effectives des métiers et un niveau de pénibilité reconnu.
par Farida Tahar | 28 avril 2021 | Au parlement, Emploi et formation, Parlement Bruxellois
Le groupe Ecolo est particulièrement attentif à pouvoir expérimenter le dispositif de territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) en Région bruxelloise. Lors des discussions budgétaires de décembre dernier, nous avons constaté qu’aucun budget n’était prévu cette année pour la mise en œuvre d’une telle expérimentation. À l’époque, selon vous, M. le ministre, ce projet nécessitait encore de nombreuses discussions avec les autres Régions et le gouvernement fédéral, notamment quant à son financement.
Dans le modèle français que nous souhaiterions voir reproduit en Belgique, il est vrai que le financement des TZCLD est en grande partie assuré par les allocations destinées aux chômeurs volontaires dans le projet. Elles sont attribuées à la création d’entreprises à but d’emploi (EBE) qui peuvent alors financer des contrats d’embauche à durée indéterminée, pour ces mêmes chômeurs volontaires. Un tel dispositif nécessite donc l’engagement des autorités fédérales, afin de pouvoir activer les allocations de chômage pour les projets de TZCLD. L’accord ²du gouvernement Vivaldi ouvre la porte à une mise en œuvre concertée du dispositif TZCLD au niveau régional.Vous nous avez communiqué, en décembre, avoir déjà interpellé à ce sujet le ministre fédéral de l’emploi, M. Pierre-Yves Dermagne.
-> Ma question détaillée et la réponse en page 15 et suivantes : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00126/images.pdf
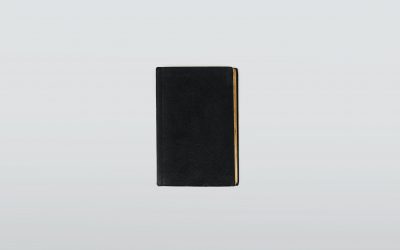
par Farida Tahar | 28 avril 2021 | Au parlement, Emploi et formation, Questions parlementaires, Travail politique
Le 12 mars dernier, une délégation d’aides ménagères vous a remis en mains propres leur « livre noir ». Il contient des témoignages durs et poignants sur la réalité quotidienne des travailleuses domestiques, dont les conditions de travail se sont encore dégradées durant la crise sanitaire.
Elles sont environ 160.000 à travailler dans ce secteur en Belgique pour un salaire horaire de 11,04 euros à l’embauche. À Bruxelles, cela représente 20.000 emplois. Dans leur écrasante majorité, ces travailleuses rencontrent de grosses difficultés économiques, quand elles ne sont pas en situation de grande précarité. Cette réalité tend à s’aggraver en période de crise, tant nous savons combien ce public féminin est à la croisée d’une série d’inégalités sociales. Pourtant, leur rôle a été crucial pendant la crise sanitaire et le restera après la pandémie. Si certaines ont pu continuer à travailler, d’autres ont dû recourir au chômage temporaire, avec toutes les conséquences que cela implique, dont une diminution de salaire (près de 1.000 euros) et la perte d’avantages comme la prime de fin d’année. Pour faire face à ces nombreuses difficultés, le secteur propose une série de pistes, dont la valorisation du statut et des conditions de travail, ou encore la réalisation de tests proactifs par l’inspection régionale de l’emploi.
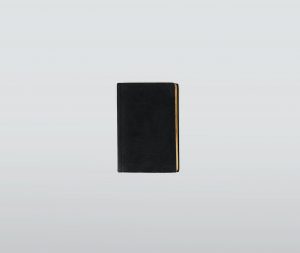
-> Réponse à mes questions en page 27 : http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00126/images.pdf